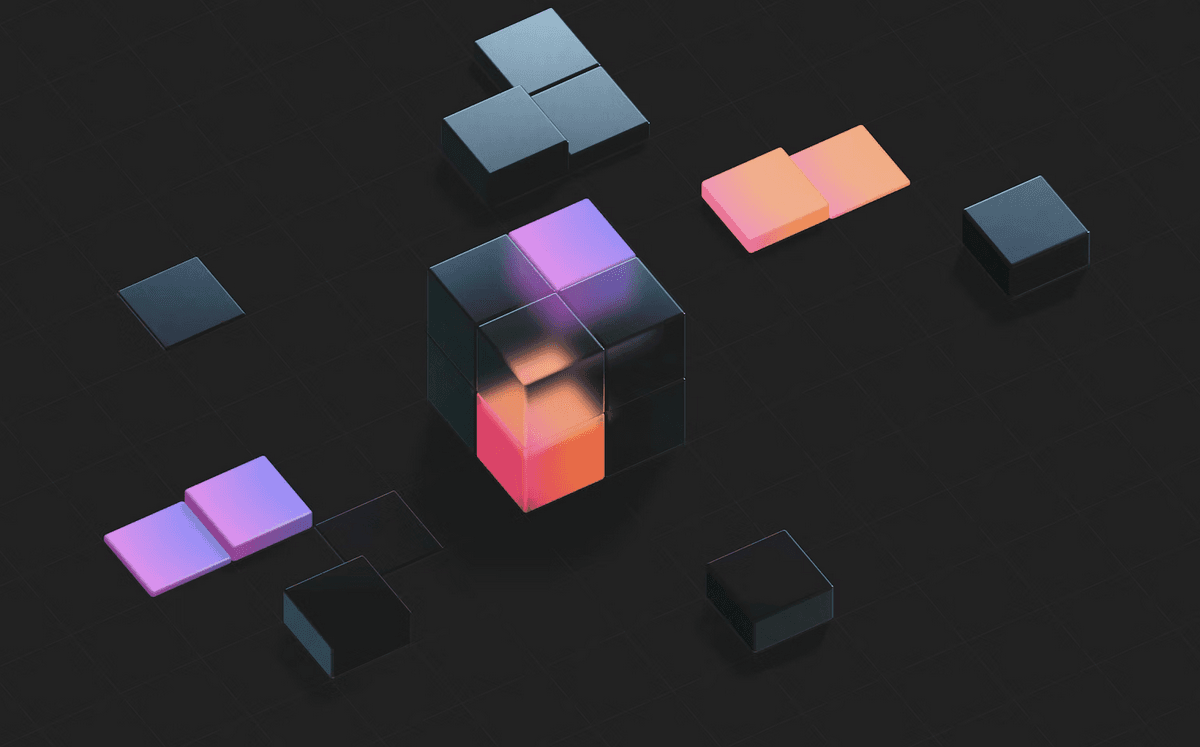
IA Souveraine Définition
Qu'est-ce que l'IA souveraine ? Cet article cherche à définir ce concept stratégique et explore pourquoi la maîtrise des données, des modèles et des infrastructures est essentielle pour la sécurité et l'autonomie.
Le RAG assure que l’IA exploite les spécificités et le savoir interne de l’entreprise – facteur décisif pour obtenir un impact réel et durable – Synclab vous accompagne dans le déploiement de votre RAG on-premise.

Les avancées des LLM (Large Language Models) – tels que GPT-4, Llama 3, ouvrent la voie à de nouvelles applications d’IA générative en entreprise. Cependant, un modèle de langage seul peut montrer ses limites sur des informations spécifiques ou récentes. C’est là qu’intervient le RAG (Retrieval-Augmented Generation), ou génération augmentée par récupération. Cette technique consiste à connecter un modèle de langage aux données internes de l’entreprise pour enrichir ses réponses.
En pratique, le LLM puise dans une base de connaissances dédiée (souvent stockée sous forme de vecteurs représentant le sens des documents) afin de fournir des réponses plus précises et actualisées (pour en savoir plus sur le fonctionnement technique du RAG vous pouvez lire notre article sur Le RAG comment ça marche ?). Le RAG assure ainsi que l’IA exploite les spécificités et le savoir interne de l’entreprise – facteur décisif pour obtenir un impact réel et durable.
Déployer un système RAG on-premise signifie que toutes les données et l’infrastructure restent hébergées en interne, sur les serveurs de l’entreprise (ou son cloud privé). Cela présente de forts enjeux en matière de stockage et gestion des données. D’une part, il faut constituer la base de connaissances : agréger les documents internes (textes, PDF, comptes-rendus, emails, données métier…), les convertir en vecteurs via un modèle d’embedding, et les indexer dans une base vectorielle performante. Cette étape peut représenter des volumes de données conséquents à héberger localement. Il convient donc de prévoir une infrastructure de stockage scalable, avec des mécanismes de sauvegarde et de réplication, tout en veillant à la confidentialité de ces informations sensibles.
En environnement on-premise, la responsabilité des données incombe entièrement à l’entreprise. Cela signifie maîtriser les cycles de vie des données (mise à jour des vecteurs lors de l’ajout ou modification de documents), garantir leur intégrité, et assurer la conformité aux régulations (RGPD, secret professionnel, etc.). L’avantage est bien sûr que les informations ne quittent pas le périmètre de sécurité de l’organisation. Dans des secteurs comme la finance ou le juridique, beaucoup d’acteurs hésitent à utiliser le cloud public précisément à cause des risques sur la confidentialité et la conformité
Un déploiement on-premise permet de garder des documents sensibles (comptes rendus financiers, dossiers clients, contrats…) au sein du SI de l’entreprise, réduisant drastiquement les risques de fuite de données. Si tout se passe en local, on élimine la possibilité de brèches externes.
Cependant, stocker en interne implique aussi de bien administrer ces données. Il faut disposer des compétences pour gérer la base vectorielle (par ex. Milvus, Elasticsearch, FAISS ou PGVector), assurer sa sécurité (chiffrement des données, contrôles d’accès stricts) et sa performance. La gestion des accès utilisateurs à l’outil RAG doit également être maîtrisée pour éviter qu’une personne non autorisée n’interroge l’IA sur des informations confidentielles. En somme, l’on-premise offre un contrôle total sur les données, ce qui est un atout, mais nécessite en contrepartie une gouvernance rigoureuse et des procédures solides en matière de gestion et protection des informations.
Face à l’essor des solutions cloud d’IA, il est crucial d’évaluer les avantages et contraintes du on-premise par rapport au cloud pour un système RAG. Les deux options ne s’opposent pas systématiquement – on voit d’ailleurs émerger des approches hybrides – mais elles répondent à des besoins différents. Voici les principaux points de comparaison :
C’est souvent l’argument n°1 du on-premise. Héberger l’IA en interne garantit un contrôle complet sur les données traitées. Aucune information sensible n’est envoyée à un service tiers, ce qui élimine les inquiétudes liées aux lois extraterritoriales ou aux failles chez un prestataire cloud. Pour les organisations soumises à des régulations strictes (banque, santé, défense…), le on-premise est presque un passage obligé afin d’assurer que aucune donnée ne sort de leur environnement sécurisé
À l’inverse, une solution cloud implique de faire confiance au fournisseur quant à la protection des données. Malgré les hauts niveaux de sécurité affichés par les grands clouds, certaines entreprises ne peuvent se permettre ce risque.
Les modèles économique diffèrent radicalement. Sur le cloud, on paye à l’usage (par requête ou par volume de tokens générés). Cela évite un investissement initial, et s’avère idéal pour un usage ponctuel ou imprévisible, car on ne paye que ce que l’on consomme
En revanche, à forte échelle et usage constant, la facture cloud peut vite s’envoler et devenir bien plus élevée qu’une infrastructure interne. Payer des requêtes API en continu sans posséder l’infrastructure est parfois un « lose-lose » : gros chèque mensuel et dépendance vis-à-vis d’un tiers
Le on-premise nécessite un investissement initial significatif (achat de serveurs, GPU, stockage…), ainsi que des coûts d’exploitation (maintenance, énergie). Mais sur le long terme, pour un volume de requêtes élevé et stable, l’option interne peut revenir moins cher
On peut voir cela comme un arbitrage CAPEX vs OPEX : investir en capital pour s’éviter des dépenses opérationnelles variables.
une solution cloud offre une élasticité quasi-infinie – l’infrastructure s’adapte automatiquement aux pics de charge, sans intervention. On bénéficie de la puissance de grands datacenters, avec une mise à l’échelle transparente. Cela simplifie le démarrage et les tests : on peut prototyper un chatbot intelligent sans se soucier des serveurs, puis augmenter la capacité en quelques clics si l’usage grimpe
En contrepartie, c’est une moindre maîtrise de l’environnement : on est tributaire des limites imposées (quotas, latence réseau) et on peut difficilement optimiser finement les performances.
En on-premise, scaler demande du temps et de l’anticipation : ajouter des GPU, déployer de nouveaux nœuds, configurer l’orchestration (Kubernetes, Docker compose, etc.). Cela requiert une expertise DevOps pour éviter les points de congestion et assurer la haute disponibilité. À petite échelle, un serveur unique peut suffire, mais si la base d’utilisateurs augmente, il faudra prévoir la capacité additionnelle à l’avance (commande de matériel, installation). L’on-premise offre donc une maîtrise totale de l’infrastructure (on peut l’optimiser à sa guise), mais exige en contrepartie une bonne compréhension technique pour la maintenir et la faire évoluer.
déployer en interne permet de choisir n’importe quel modèle (open-source, éventuellement fine-tuné sur vos données) et de le configurer comme bon vous semble. Vous pouvez, par exemple, affiner un LLM sur vos textes métier pour en améliorer la pertinence, chose impossible avec une API cloud propriétaire. Ce degré de personnalisation est un atout du on-premise, crucial si l’IA est au cœur de votre avantage concurrentiel.
En cloud, on est limité aux modèles proposés par le fournisseur et à leurs paramètres par défaut (même si des options de fine-tuning commencent à émerger chez certains). D’autre part, en self-hosted, on garde la main sur les versions : vous pouvez décider de passer sur un nouveau modèle plus performant ou au contraire d’en conserver un ancien pour des raisons de stabilité, sans dépendre du calendrier d’un tiers. Cette liberté a pour corollaire la nécessité de gérer les mises à jour : il faudra tester les nouvelles versions de modèle, surveiller les patchs de sécurité, etc. En somme, le on-premise apporte flexibilité et customisation maximales, tandis que le cloud privilégie la simplicité d’utilisation immédiate.
En résumé, le choix cloud vs on-premise dépend des besoins spécifiques de l’organisation : exigences de sécurité, budget, volume d’utilisation, expertise disponible, etc. L’option on-premise offre un contrôle accru et des coûts potentiellement moindres à grande échelle, mais s’accompagne de coûts initiaux et d’une complexité de gestion plus élevée. Le cloud assure rapidité de déploiement, souplesse et coûts variables, mais avec moins de contrôle et un risque sur la confidentialité. De plus en plus d’entreprises optent pour un mode hybride : par exemple, utiliser un service cloud pour les usages généraux ou en pointe (où l’élasticité est cruciale), et réserver un LLM interne pour les données ultra-sensibles ou pour réduire les coûts une fois le volume devenu important.
Le déploiement on-premise d’un système RAG nécessite une attention particulière à l’infrastructure matérielle. En effet, les performances et la capacité à servir de nombreux utilisateurs vont dépendre directement des ressources de calcul disponibles, en particulier pour l’inférence du modèle de langage. Quel matériel prévoir, et pour combien d’utilisateurs ? C’est une question centrale dès la phase de conception.
Deux composantes matérielles se distinguent dans un système RAG : (1) les ressources pour faire tourner le LLM (typiquement des GPU pour accélérer les calculs massivement parallèles du réseau de neurones) et (2) les ressources pour la base vectorielle (CPU, RAM, et parfois même d’autres GPU pour l’embedding ou la recherche sémantique).
Un LLM de plusieurs dizaines de milliards de paramètres consomme énormément de VRAM et de puissance de calcul pour générer des réponses rapidement. À l’extrême, les plus gros modèles (ex: 700B paramètres) demandent plusieurs GPU haut de gamme en parallèle pour atteindre des latences acceptables. – ce qui donne une idée de la puissance mobilisée. Une telle configuration pourrait soutenir des dizaines de requêtes utilisateurs par seconde avec des réponses assez longues. C'est généralement ce genre de configuration que l'on retrouve sur les désormais célébre ferme à GPU. À l’inverse, des modèles plus légers (70B, 13B paramètres) peuvent tourner sur un cluster limité de GPU voir sur un seul GPU. Des modèles compacts ~2–3B paramètres spécialement optimisés peuvent même s’exécuter sur des processeurs classiques sans accélération GPU, ce qui est idéal pour du prototypage ou des cas d’usage très limités
Bien sûr, le revers d’un modèle plus petit est souvent une qualité de réponse inférieure, il faut trouver le bon compromis taille/performance en fonction de l’usage.
Il faut estimer le nombre de requêtes par seconde (QPS) que le système devra supporter aux heures de pointe. Par exemple, si l’on prévoit 10 utilisateurs concurrents, chacun posant des questions qui génèrent ~200 tokens de réponse, et que l’on vise une latence de 10 secondes par réponse, il faudrait pouvoir générer ~10*200/10 = 200 tokens par seconde en crête. On dimensionnera donc le nombre de GPU en conséquence. Un GPU performant actuel peut souvent délivrer de l’ordre de quelques dizaines de tokens par seconde sur un modèle 70B avec un quantization légère – disons ~20 tokens/s en mono-thread pour fixer les idées
Ces petits calculs illustrent l’importance de benchmarker le modèle choisi sur le matériel envisagé, puis de faire une extrapolation selon la charge attendue. Il est prudent de prévoir une marge (pour absorber les pics imprévus) ou des capacités d’évolutivité (ex: possibilité d’ajouter un 2ème nœud avec d’autres GPU).
Outre les GPU, n’oublions pas que la base vectorielle et l’application web qui sert d’interface utilisateur tournent sur des CPU. Il faut suffisamment de RAM pour charger tous les vecteurs en mémoire (si la base fait par ex. 100 millions de vecteurs, cela peut représenter plusieurs dizaines de Go). Les requêtes de similarité dans la base vectorielle sont très rapides (quelques millisecondes) tant que les données tiennent en RAM et que l’index est bien optimisé. Le stockage doit être suffisamment spacieux pour contenir l’index vectoriel et les documents sources, avec des disques rapides de préférence (SSD/NVMe) pour accélérer l’ingestion de nouvelles données et les backups. Enfin, le réseau interne doit être dimensionné pour supporter les échanges entre le backend LLM et la base vectorielle si ceux-ci sont sur des serveurs distincts (dans certains cas, tout peut résider sur le même serveur physique, simplifiant l’architecture).
En résumé, la performance d’un RAG on-premise est directement liée au hardware alloué. Mieux vaut voir un peu large lors du dimensionnement initial, quitte à commencer avec un modèle plus petit ou moins de GPU puis rajouter de la capacité en fonction de l’adoption. Des tests de charge et mesures de latence dès le pilote sont fortement recommandés pour éviter les mauvaises surprises en production. Le bon côté, c’est qu’en maîtrisant l’infrastructure, on peut optimiser chaque composant : par exemple, intégrer la base vectorielle in-process dans le même serveur que le LLM pour éliminer la latence réseau (pertinent pour un usage modéré), ou au contraire séparer les rôles sur plusieurs machines pour mieux paralléliser quand l’usage croît. Cette liberté de choix architectural est un atout du on-premise – à condition de posséder les ressources matérielles nécessaires à ses ambitions.
Malgré ses nombreux atouts, le déploiement d’un système RAG en interne s’accompagne de défis importants qu’il convient d’anticiper. Trois enjeux majeurs se dégagent : la performance, le coût et la sécurité (auxquels on peut ajouter la complexité opérationnelle). Trouver le bon équilibre entre ces facteurs est la clé du succès à long terme.
un assistant conversationnel ou un outil de question-réponse alimenté par un LLM doit idéalement fournir des réponses de façon fluide, en quelques secondes maximum. Atteindre cette basse latence est un vrai défi technique. En on-premise, il faut optimiser chaque étape : temps d’inférence du LLM, temps de requête dans la base vectorielle, overhead d’intégration entre les deux. L’absence de transit réseau externe joue en faveur d’une latence réduite (pas de va-et-vient jusqu’au cloud), ce qui peut donner une expérience plus réactive qu’avec certaines APIs distantes.
Néanmoins, si l’infrastructure est sous-dimensionnée, le risque est d’obtenir des délais trop longs dès que plusieurs utilisateurs sollicitent l’IA en même temps. Il faudra donc relever le défi de la scalabilité interne pour soutenir la montée en charge : cela passe par du matériel adapté (comme vu précédemment), mais aussi par des optimisations logicielles (ex : quantification du modèle pour accélérer les calculs, usage d’outils comme DeepSpeed, vLLM ou TensorRT pour augmenter les tokens/sec, etc.). L’objectif est de garantir une performance stable, même lorsque l’usage grandit – sans quoi l’adoption par les utilisateurs finaux pourrait être compromise.
Si le on-premise évite les factures mensuelles variables du cloud, il nécessite en revanche un investissement initial financier et humain non négligeable. Le coût des GPU, en particulier, reste très élevé (plusieurs dizaines de milliers d’euros pour des machines performantes). À cela s’ajoutent les coûts d’électricité (faire tourner des serveurs gourmands 24/7 n’est pas anodin), de refroidissement, d’entretien du matériel, etc.
De plus, il faut mobiliser des équipes techniques compétentes pour installer, paramétrer et maintenir l’ensemble du pipeline IA. On parle ici de data engineers, d’ingénieurs ML Ops, d’administrateurs systèmes… Ces talents ont un coût et doivent être disponibles en interne ou via des prestataires. L’entreprise devra donc évaluer si elle a la taille critique et les moyens pour supporter cette infrastructure sur la durée. Cela dit, on l’a mentionné, ces coûts peuvent s’avérer payants sur le long terme si l’utilisation du RAG est intensive et stratégique. Il est utile de calculer un ROI : à partir de quel volume de requêtes ou d’utilisateurs le on-premise devient-il moins cher qu’une solution cloud équivalente ? En outre, des stratégies peuvent aider à contenir les coûts : par exemple utiliser un modèle open-source plus petit mais finement adapté à son domaine plutôt qu’un énorme modèle générique, ce qui réduit les besoins GPU sans sacrifier la pertinence.
Dans une approche pragmatique, commencer avec un modèle modeste (donc peu coûteux à faire tourner) permet de prouver la valeur du cas d’usage, avant d’envisager d’éventuels investissements additionnels si le succès est au rendez-vous.
Un argument du on-premise est la sécurité, mais cela ne veut pas dire que le défi disparaît – il change de nature. Sécuriser un déploiement IA interne exige de mettre en place toutes les bonnes pratiques IT : pare-feu, segmentation réseau, contrôle des accès utilisateurs, surveillance des logs, mises à jour régulières des systèmes et librairies pour corriger les vulnérabilités, etc. La sécurité physique entre aussi en jeu (protéger l’accès aux serveurs). Si l’application RAG délivre des informations sensibles, il faudra également penser à la journalisation et au chiffrement des données échangées, surtout si l’outil est accessible sur un intranet large. Un défi spécifique aux LLMs est d’éviter les fuites de données involontaires : par exemple, s’assurer que l’IA ne restitue pas à un utilisateur non autorisé un contenu qu’il n’est pas censé voir, en mettant en place des garde-fous (filtrage des résultats de la base vectorielle par permissions, etc.). De plus, il faudra garantir la disponibilité du service : en on-premise, pas de SLA d’un fournisseur cloud, c’est à l’équipe interne de maintenir un haut niveau de fiabilité. Redondance des serveurs, sauvegardes fréquentes, plan de reprise sur incident… autant de considérations à adresser pour un service critique. Enfin, soulignons que l’on-premise libère de certaines menaces (ex : attaques via l’API ou l’account cloud), mais expose à d’autres (attaques internes, ransomware sur le datacenter, etc.) – la sécurité doit donc rester une priorité de tous les instants.
En somme, performance, coût et sécurité forment un triangle d’équilibre pour le déploiement on-premise. Maximiser l’un sans négliger les autres est un exercice d’arbitrage que chaque entreprise devra réaliser en fonction de ses objectifs. La réussite d’un projet RAG interne tient autant à la qualité technologique de la solution qu’à la maîtrise de ces enjeux opérationnels tout au long de son cycle de vie.
Pour mieux comprendre les enjeux, envisageons quelques cas d’utilisation concrets d’un système RAG on-premise :
Un grand cabinet d’avocats décide de déployer un assistant conversationnel alimenté par un LLM, afin d’aider ses juristes à naviguer dans la masse de documents juridiques internes (notes de doctrines, précédents, contrats, réglementations spécifiques au client, etc.). La nature hautement confidentielle de ces documents impose un hébergement sur site. Le système RAG va indexer des milliers de dossiers et permettre aux avocats de poser des questions en langage naturel (ex : « Quelle est la clause sur la résiliation dans le contrat X ? ») et de recevoir en réponse des extraits pertinents soulignés, accompagnés d’une synthèse générée. Ce déploiement on-premise garantit que les secrets de leurs clients ne transitent pas par le cloud et reste conforme aux exigences déontologiques. Le défi pour le DSI sera de fournir assez de puissance de calcul pour répondre rapidement aux requêtes en pleine période d’activité (par ex. bouclage d’une négociation contractuelle) tout en maîtrisant les coûts. Ici, la valeur ajoutée est claire : un gain de productivité et une meilleure capitalisation du savoir du cabinet, rendu possible uniquement grâce à une solution déployée en interne pour des raisons de confidentialité.
Une banque souhaite améliorer le support interne de ses conseillers clientèles en leur fournissant un chatbot IA capable de répondre instantanément à des questions sur les procédures, produits financiers et données clients. Elle opte pour un déploiement on-premise afin de respecter les normes de sécurité financières (aucune donnée client ne doit sortir de l’infrastructure) et de pouvoir auditer complètement le système. Le RAG va puiser dans les bases de données internes de la banque – manuels de procédure, FAQ réglementaires, historiques de transactions – pour formuler des réponses précises. Par exemple, un conseiller pourra demander « Que doit-on vérifier pour approuver un prêt habitat de plus de 300 000 € ? » et l’IA lui fournira la liste des vérifications selon le manuel interne, avec les chiffres mis à jour. Ce cas d’usage montre l’intérêt de la fraîcheur des données : la banque peut mettre à jour ses politiques et voir ces changements reflétés immédiatement dans les réponses de l’IA (chose qu’un modèle pré-entraîné seul ne permettrait pas). Le déploiement on-premise doit ici relever les défis de performance (des centaines de conseillers pourraient solliciter le chatbot en même temps le matin), et de sécurité (l’outil ne doit en aucun cas divulguer les informations d’un client à un autre conseiller n’ayant pas les droits, par exemple). Grâce à une architecture bien pensée et à des filtres d’accès sur la base vectorielle, la banque parvient à déployer ce service innovant tout en restant conforme aux réglementations (secret bancaire, RGPD).
Une entreprise du secteur industriel possède des décennies de documents techniques (plans, spécifications, rapports R&D, retours d’expérience) qu’elle souhaite rendre accessibles via une IA à ses ingénieurs. Ces données constituant un atout concurrentiel majeur, il est exclu de les héberger chez un cloud public. Un système RAG on-premise est mis en place, permettant aux ingénieurs de questionner l’IA sur, par exemple, « les causes de la panne type A sur la machine Y » et d’obtenir un condensé des rapports internes liés à ce sujet. Outre la recherche sémantique ultra-rapide dans cette base de connaissance, le LLM peut traduire des documents techniques complexes en un langage plus clair pour faciliter la compréhension en interne. Ce cas d’usage illustre la pérennisation du savoir : même si des experts partent à la retraite, leurs rapports restent exploitables aisément via l’IA. L’on-premise facilite également l’intégration avec les systèmes existants de l’entreprise (intranet, gestion documentaire interne), sans soucis de compatibilité avec des services cloud. Le principal défi ici sera d’entretenir la qualité du système sur la durée : s’assurer d’ajouter régulièrement les nouveaux documents produits dans l’index, mettre à jour le modèle si nécessaire pour qu’il reste performant sur le jargon métier de l’entreprise, etc.
Ces exemples concrets démontrent comment un RAG on-premise peut apporter de la valeur dans divers secteurs, à condition d’être aligné avec les contraintes métiers et réglementaires. A chaque fois, la maîtrise des données et la personnalisation au contexte font la différence par rapport à une solution générique cloud. Ils soulignent aussi que la réussite repose autant sur la technologie que sur la bonne compréhension des enjeux métier et la gestion du changement auprès des utilisateurs (former les juristes ou conseillers à utiliser l’outil, instaurer la confiance dans ses réponses, etc.).
Pour conclure, voici quelques recommandations clés destinées à guider un déploiement on-premise d’un système RAG dans les meilleures conditions :
Le « plus gros » n’est pas toujours le « mieux ». Analysez vos besoins en termes de complexité des questions et de précision requise, puis optez pour le modèle LLM le plus léger possible qui atteint ce niveau de performance. Un modèle de 7 ou 13 milliards de paramètres fine-tuné sur vos données peut souvent rivaliser avec un 70 milliards générique sur des questions pointues de votre domaine. L’avantage d’un modèle plus petit, c’est une empreinte calcul réduite (donc moins de GPU nécessaires) et des coûts moindres, pour un résultat fonctionnellement satisfaisant. N’hésitez pas à tester plusieurs modèles (y compris des open-source récents) pour trouver le bon équilibre entre qualité des réponses et contraintes matérielles.
Exploitez les nombreuses techniques d’optimisation d’inférence qui existent. Par exemple, utilisez la quantification pour réduire la taille mémoire du modèle (passer en 4 bits ou 8 bits au lieu de 16/32 bits), ce qui peut permettre de faire tenir un modèle sur moins de GPUs sans perte notable de qualité. Tirez parti des frameworks optimisés comme TensorRT, ONNX Runtime, ou des serveurs spécialisés (ex: vLLM) qui gèrent mieux le parallélisme et le caching des résultats partiels. Configurez le batching de requêtes si vous avez beaucoup de questions simultanées : traiter plusieurs requêtes en parallèle sur le GPU peut améliorer le throughput, à condition de ne pas trop augmenter la latence. Côté base vectorielle, ajustez les paramètres d’index (méthode d’approximation, nombre de clusters/probes) pour accélérer les recherches tout en conservant un rappel suffisant. Une approche RAG efficace nécessite que chaque milliseconde gagnée sur la recherche ou l’inférence compte, surtout à grande échelle.
Envisagez dès le départ comment vous allez déployer et orchestrer votre solution. L’usage de conteneurs Docker est quasi indispensable pour encapsuler le modèle et ses dépendances, de même que la base vectorielle. Des outils comme Kubernetes peuvent aider à gérer le scaling horizontal (lancement de pods supplémentaires en cas de charge, répartition des requêtes). Pensez également à la séparation des environnements : prévoyez un environnement de test où essayer les nouveaux modèles ou mises à jour avant de les basculer en production, afin d’éviter les interruptions de service. Une fois en production, assurez un monitoring attentif : métriques de latence, d’utilisation GPU/CPU, taux d’erreur, feedback des utilisateurs… Ces indicateurs vous permettront d’anticiper les besoins d’extension de l’infra ou d’optimisation.
Même en interne, appliquez les principes de zero trust. Isolez autant que possible le serveur hébergeant le LLM et la base vectorielle sur un segment réseau restreint. Mettez en place une authentification forte pour l’accès à l’application RAG (par ex. via l’AD/LDAP de l’entreprise) de sorte que seules les personnes autorisées puissent interroger l’IA. Logguez toutes les requêtes et réponses (en veillant à ne pas exposer d’infos sensibles dans les logs) afin de pouvoir auditer qui a demandé quoi. Si l’IA est amenée à délivrer des données confidentielles, implémentez un système de permissions sur les documents : par exemple, coupler la requête de l’utilisateur à son service/département pour filtrer les résultats de la base vectorielle en conséquence (un peu à la manière d’un contrôle d’accès aux documents). Testez la robustesse de votre installation via des audits de sécurité et des scenarii d’incidents (que se passe-t-il si un serveur tombe en panne ? si une réponse inappropriée est générée et partagée ? etc.). Votre objectif doit être que le déploiement on-premise inspire confiance aux équipes dirigeantes autant que s’il s’agissait d’une solution cloud réputée – car la moindre faille pourrait remettre en cause l’acceptabilité du projet.
L’écosystème des LLM évolue vite. Restez en veille sur les avancées (nouveaux modèles open-source plus performants, améliorations des librairies d’inférence, corrections de bugs de votre stack logicielle). Planifiez des mises à jour régulières de votre solution RAG. Cela peut vouloir dire réentraîner ou affiner le modèle de temps en temps avec de nouvelles données internes, ou carrément remplacer le modèle par un plus récent si un saut technologique se produit. Grâce au on-premise, vous avez la liberté de le faire ; mais veillez à le faire de façon contrôlée (tests A/B avant/après par exemple pour vérifier que le nouveau modèle est meilleur). De même, surveillez l’évolution de vos volumes de données et du nombre d’utilisateurs : un succès de l’outil pourrait nécessiter d’ajouter des nœuds de calcul, d’augmenter la capacité de la base vectorielle ou d’améliorer l’interface utilisateur. En anticipant ces évolutions, vous éviterez d’être pris de court. En bref, considérez votre RAG on-premise comme un produit vivant qu’il faut faire grandir et adapter en continu, et non comme une simple installation « plug-and-play » figée.
En suivant ces conseils, une entreprise met toutes les chances de son côté pour tirer le meilleur parti d’un déploiement on-premise d’un système RAG. Ce mode de déploiement, bien qu’exigeant, peut offrir un retour sur investissement considérable en exploitant pleinement la richesse des données internes tout en gardant la maîtrise totale sur l’IA. C’est un chemin qui demande de la préparation et de la rigueur, mais pour de nombreuses organisations, il s’agit du passage obligé vers une IA générative de confiance, performante et alignée sur les besoins métiers. Les bénéfices en termes de compétitivité, d’efficacité opérationnelle et d’innovation valent largement ces efforts lorsque le projet est bien conduit.
Si vous souhaitez en savoir plus sur le déploiement d’un RAG on-premise, ou si vous avez un projet en tête et cherchez des conseils pour le mener à bien, n’hésitez pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous accompagner dans cette aventure et de vous aider à concrétiser votre vision de l’IA conversationnelle en entreprise.
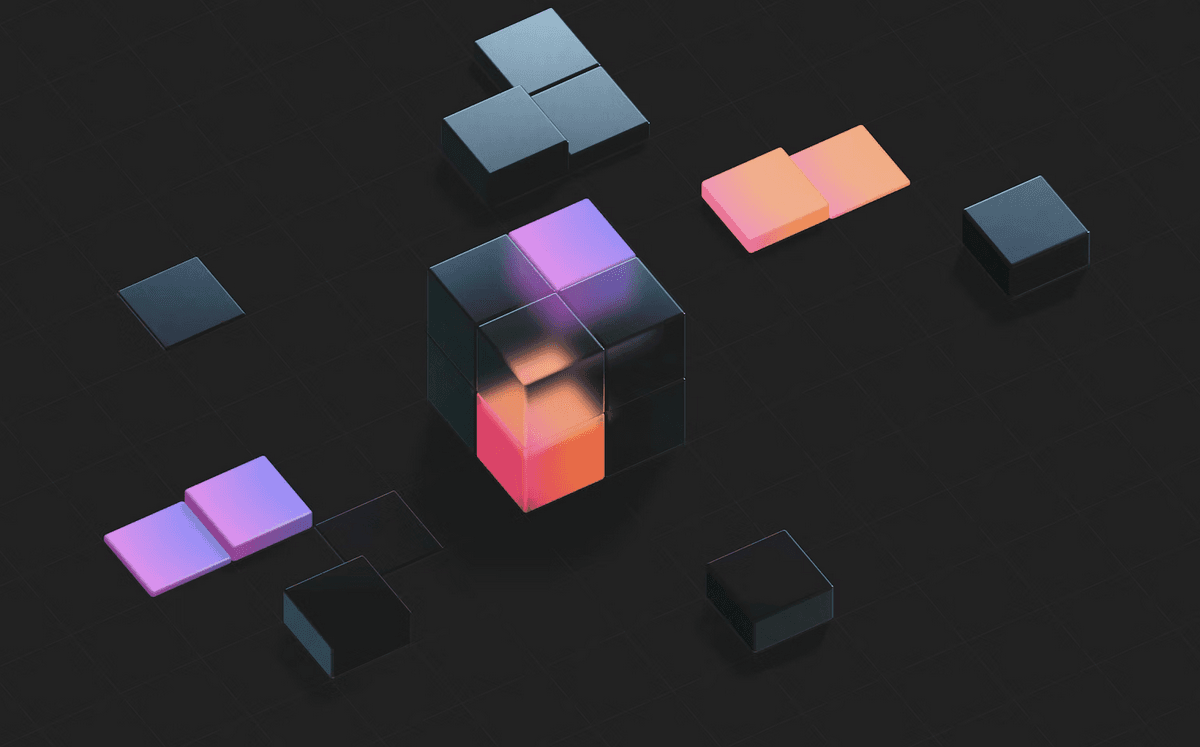
Qu'est-ce que l'IA souveraine ? Cet article cherche à définir ce concept stratégique et explore pourquoi la maîtrise des données, des modèles et des infrastructures est essentielle pour la sécurité et l'autonomie.

Découvrez comment bâtir une stratégie d'IA pour votre entreprise qui génère un ROI mesurable. Guide complet 2025 : audit, KPIs, gouvernance et conformité RGPD